François le champi
Si parfois, comme George Sand, il vous arrive d'être gagnés par la tourmente du monde, de la politique, de la finance et de leurs affaires, lassés de la consommation galopante et même des artifices des relations humaines, de l'art, bref de notre époque, voici un petit roman datant de plus d'un siècle et demi qui pourrait vous rafraîchir, vous apporter un souffle d'authenticité, de bonté, en vous faisant plonger en quelques sources toujours vives. François le champi, ce titre vous dit quelque chose ?
Une première tentative de lecture, à vingt-cinq ans, m'avait paru beaucoup trop sentimentale, avec des personnages entiers et fortement idéalisés. La femme était trop bonne, le mari trop rustre et l'enfant recueilli - en cachette - se perdait en reconnaissance et quête d'affection, tout en effectuant un travail surhumain. Originaire moi-même d'une ferme, cela me choquait et j'attendais autre chose d'un bon roman !
Trente et un ans se sont écoulés
- Mais voui, bon anniversaire "ma vieille" !-
et mes critères d'appréciation ont sensiblement évolué.
Alors quand, cet été, Milly la Québécoise, m'a invitée à
une lecture commune de George Sand, le défi m'a plu.
Merci la belle de la lointaine province ;-)
Mon choix s'est bien évidemment
porté sur …
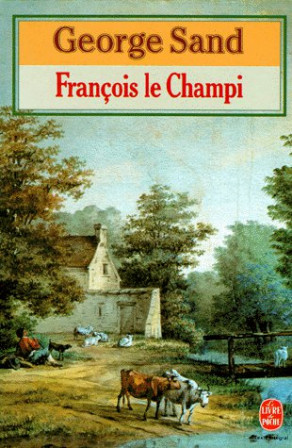
François le Champi, George Sand, 1848.
"En cet endroit de l’histoire, la raconteuse s’arrêta."
C'est en effet la bonne du curée qui, avec l'aide du chanvreur (au moment où les choses deviennent plus délicates), relate aux paroissiens rassemblés pour la veillée, une histoire qui se serait déroulée dans le pays (le Berry) :
Madeleine, la douce femme d'un meunier, après avoir rencontré à la fontaine un garçonnet d'allure simplette, un champi confié à une miséreuse, décide, à l'encontre de l'avarice et de la méfiance de son entourage, de lui venir en aide.
Pas facile pour un champi, de grandir et de se construire lorsque de l'avis général cette engeance porte en elle tous les vices ! Mais Madeleine, n'écoutant que son bon cœur, considère l'enfant, au fil des travaux et des saisons, comme son propre fils. Et celui-ci va lui rendre ses bons soins au centuple ! Habileté, dévouement exceptionnel, beauté, développement progressif de son intelligence - malgré un manque certain d'aisance avec les autres - et surtout gratitude et bonté exprimées sans relâche.
Bien sûr, revers de la médaille, les mauvaises langues ne tardent pas à aller bon train, éloignant du moulin le champi, devenu un beau jeune homme … Alors les nuages s’amoncellent : le mari, parti vivre avec une maîtresse, accumule les dettes, installe sa jeune sœur délurée auprès de sa femme et finalement meurt tandis que les créanciers piaffent d'impatience, qu'un lourd procès menace et que Madeleine, rompue de fatigue, sombre progressivement dans la maladie.
Après tout l'amour généreusement offert par cette femme, on espère et on devine qu'il se trouvera un bon esprit, quelque part, pour chasser le malheur et … Tatata ! Taise ta goule, Lily !

"Nasturce" (ou cresson de fontaine) Gustave Caillebotte (1848-1894)
Empreinte de légendes, comme par exemple ici celle des fontaines, la culture des hommes et femmes de la campagne se nourrit, au fil des fêtes et des saisons, de la poésie des paysages, des métiers de la terre et des traditions. Aussi, lors des veillées, l'éloquence dont ils sont pourvus, leur grande présence, parviennent à faire toucher à une fraîcheur tout à fait inédite. Le fait de sentir en même temps que l'auditoire la "piquette du jour", la "secousse d'un instant" ou le" réveillon qu'on peut donner au plaisir de se montrer charitable" est une belle jouissance qui permet d’accéder à de nobles sentiments, tout autant que les œuvres d'art prisées à Paris.
Mais plus profondément, l'auteur dévoilant et mettant en scène le quotidien, la foi et les désirs des humbles travailleurs des campagnes souhaite, sans occulter leurs nombreux travers, mettre en valeur leur dignité, donner à goûter leur grandeur et même chose surprenante, leur ouverture d'esprit et leur capacité à évoluer. Il suffit à plusieurs reprises d'entendre la position des deux conteurs pour s'en convaincre, mais on voit nettement aussi, comment l'attitude de Madeleine face à son rustre de mari peut gagner en consistance et juste autorité.
Bien qu' incomplète, magnifiée et presque hors du temps, cette peinture du monde paysan, plus proche de l'esprit de Rousseau que de celui de Balzac ou de Zola, est pour moi pleine de charme et de vérités essentielles.

"Femme et vaches au bord de l'eau" Julien Dupré (1851-1910)
Si on s'attarde maintenant sur la peinture des caractères et des sentiments, le courage et la bonté de Madeleine forcent l'admiration et nous irradient complètement. George Sand a mis une grande part d'elle-même dans le portrait de cette mère : Générosité envers les pauvres, combat des idées reçues par rapport aux champis, par rapport aux femmes aussi, goût de la transmission - même si Madeleine ne possède que deux livres dont la lecture est reprise indéfiniment - et surtout dévouement, tendresse et patience en toute circonstance.
Le champi, quant à lui, est vu sous le prisme de l'amour maternel que lui prodigue Madeleine. En grandissant, n'est-il pas magnifique sous toutes les coutures, celui que tous les autres auraient rejeté ? On s'agace parfois de ce manque de justesse, mais on en sourit aussi. Tellement humain !
Par contre, j'ai été très sensible à la façon dont l'enfant se perçoit au fil du temps dans le regard des autres. La résilience, notion dont on ne parlait pas à l'époque, passe par des étapes assez finement analysées ! "… il ne parle pas et il est là comme un essoti."
A la fin du roman, on peut toutefois se demander si cette résilience est pleinement réussie … Une certaine ambiguïté permet en tout cas à l'auteur de rêver sa vie, à travers ce qui advient de la bonne meunière du Cormouer.
Malgré ce bémol, cette histoire champêtre - dont Marcel Proust aimait tant le romanesque que, à l'heure du coucher, il se la faisait lire par sa mère - est pour le XIXe siècle un plaidoyer sensible et très plaisant en faveur de tous les mal aimés : terre et traditions, paysans, femmes et bien sûr enfants abandonnés.
"Ce fut à soleil couchant que François revint au Cormouer. Il attrapa en route toute la pluie d’un orage; mais il ne s’en plaignit pas, car il avait bon espoir dans l’amitié de Jeannette, et son cœur était plus aise qu’au départ. La nuée s’égouttait sur les buissons et les merles chantaient comme des fous pour une risée que le soleil leur envoyait avant de se cacher derrière la côte du Grand-Corlay. Les oisillons, par grand’bandes, voletaient devant François de branche en branche, et le piaulis qu’ils faisaient lui réjouissait l’esprit."
Pour lire son billet, merci de faire un tour dans
"La maison de Milly"
Commentaires
Avec George Sand, tu fais remonter des souvenirs. Comme sur l’illustration de couverture du Livre de poche, enfant, j’ai gardé les vaches (je me dis aujourd’hui qu’il n’aurait sûrement pas été si compliqué de poser une clôture). Je gardais les vaches à l’ombre d’un arbre, un livre sous les yeux. George Sand faisait partie de mes lectures et c’est avec elle que j’ai découvert le mot “besson” – c’était peut-être dans la Mare au diable.
J’ai savouré ton billet puisque plein d’images me viennent en tête, comme lors de ma lecture. C’est vrai que c’était un langage près des émotions, imagé. Tu as noté plein d’expressions? Tu t’en es fait un lexique!
L’histoire en elle-même est simple. Tout est dans la manière de dire, de raconter qui fait le charme de ce roman. Merci pour la lecture commune! :)
Une lecture commune à plusieurs voix, ça c’est un beau projet, aussi bien pour l’auditeur que pour les “raconteurs”.
Et le choix des textes est tout aussi enthousiasment
chacun pénètrant dans l’univers de l’autre.
Il y a bien des textes que nous avons lu à une époque de jeunesse soit par obligation scolaire, soit par ambiance de l’époque, ou pour répondre à l’injonction “Il faut avoir lu cela ou ceci”. Mais les redécouvrir plus tard avec notre vie entre le texte et nous, ça change tout.
Lily je suis toujours enchantée de la richesse des magnifiques illustrations qui accompagnent tes billets poétiques.
Continue de nous faire rêver, merci
A propos de George, ce soir, 20 h 40 sur France 5, “George et Fanchette”, téléfilm en 2 épisodes, avec une George Sand jouée par Ariane Ascaride, qui non seulement est une actrice géniale, mais qui en plus se sentira bien dans la peau de cette militante aux idées sociales.
Le champi, lu quand j’avais 11 ans, vu 2 fois en film avec la belle Marie Dubois, et il m’a longtemps tenu compagnie…
Bizarre, les livres de Sand ( même si je ne les ai pas tous lus ), j’y passe souvent devant à la médiathèque, souvent la tentation de les relire, mais je ne le fais jamais, tant j’ai encore l’impression de les avoir dedans…
Faudrait que je tente quand même l’expérience…
Je n’ai jamais lu “François Le Champi” dans son intégralité et tu me donnes envie de le faire vraiment … Bonne journée Lily
J’aime beaucoup G.Sand, c’était, il me semble, une belle âme et son goût pour la nature et la botanique m’enchante. Je n’ai jamais lu ce livre là, une bonne occasion de le noter.Belle après-midi. brigitte
Ton beau billet, si bien illustré de mots et d’images m’a donné fort envie de me replonger dans les romans de cette chère George, grand merci.
Belle journée.
Pas de souvenirs de jeunesse concernant Georges Sand :-( Mais ton billet me donne envie de la découvrir !
J’aime beaucoup ton billet.
J’aime l’écriture de Georges Sand. Il y a peu j’ai
relu “La mare au diable”.
J’ai lu, adolescente, “la mare au diable” mais je n’en ai gardé aucun souvenir ! J’aurai bien besoin de me rafraîchir les idées avec ses livres… Ton billet est détaillé et riche d’informations. Mais pour le moment je n’ai pas envie de lire ce livre ;p
En revanche je savoure pleinement les peintures particulièrement celle de Caillebotte. Quelle belle harmonie de couleurs et comme l’eau vibre, illumine !